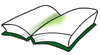Association genevoise du musée des tramways
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6700027850 | - | Périodique | Bachet | Périodiques | Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierL'avenir de la politique suisse des transports / Erhard Branger in Les transports publics, An. 7, no 4 (Avril 1951)
Titre : L'avenir de la politique suisse des transports Type de document : texte imprimé Auteurs : Erhard Branger, Auteur Année de publication : 1951 Article en page(s) : P. 3-5 Langues : Français (fre) Catégories : [Mots-clefs] Concurrence
[Mots-clefs] Législation
[Mots-clefs] Politique des transports
[Mots-clefs] Suisse
[Mots-clefs] Transport ferroviaire
[Mots-clefs] Transport public
[Mots-clefs] Transport routier
[Année] 1951Index. décimale : 2001 Transport, politique des transports - concurrence transports individuels/publics Résumé : Par deux fois, la population suisse a refusé en votation populaire l'idée d'une coordination des transports basée sur un partage du trafic inscrit dans une loi. Une commission travaille à un troisième essai d'entente directe, mais le problème est très complexe. La première étape serait de mettre sur pied d'égalité les divers moyens de transport en déchargeant ceux qui sont trop chargés. Une première inégalité existe entre les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer privés, en défaveur de ceux-ci. Entre les transports ferroviaires et routiers, les inégalités sont flagrantes: les premiers doivent construire, entretenir et exploiter à leurs frais leurs installations, alors que les seconds utilise des infrastructures mises à disposition par le contribuable. De plus, les chemins de fer sont soumis à des obligations (d'exploiter, de transporter...) et leurs tarifs sont homologués. Les différences de traitement doivent donc être supprimée avant de pouvoir songer à faire compenser par les transporteurs les prestations des pouvoirs publics.
in Les transports publics > An. 7, no 4 (Avril 1951) . - P. 3-5[article] L'avenir de la politique suisse des transports [texte imprimé] / Erhard Branger, Auteur . - 1951 . - P. 3-5.
Langues : Français (fre)
in Les transports publics > An. 7, no 4 (Avril 1951) . - P. 3-5
Catégories : [Mots-clefs] Concurrence
[Mots-clefs] Législation
[Mots-clefs] Politique des transports
[Mots-clefs] Suisse
[Mots-clefs] Transport ferroviaire
[Mots-clefs] Transport public
[Mots-clefs] Transport routier
[Année] 1951Index. décimale : 2001 Transport, politique des transports - concurrence transports individuels/publics Résumé : Par deux fois, la population suisse a refusé en votation populaire l'idée d'une coordination des transports basée sur un partage du trafic inscrit dans une loi. Une commission travaille à un troisième essai d'entente directe, mais le problème est très complexe. La première étape serait de mettre sur pied d'égalité les divers moyens de transport en déchargeant ceux qui sont trop chargés. Une première inégalité existe entre les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer privés, en défaveur de ceux-ci. Entre les transports ferroviaires et routiers, les inégalités sont flagrantes: les premiers doivent construire, entretenir et exploiter à leurs frais leurs installations, alors que les seconds utilise des infrastructures mises à disposition par le contribuable. De plus, les chemins de fer sont soumis à des obligations (d'exploiter, de transporter...) et leurs tarifs sont homologués. Les différences de traitement doivent donc être supprimée avant de pouvoir songer à faire compenser par les transporteurs les prestations des pouvoirs publics.
Titre : La soudure des joints de rails Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Maurer, Auteur Année de publication : 1951 Article en page(s) : P. 6-7 Langues : Français (fre) Catégories : [Mots-clefs] Chemin de fer
[Mots-clefs] Copenhague
[Mots-clefs] Coût
[Mots-clefs] Danemark
[Mots-clefs] Dilatation
[Mots-clefs] Infrastructure
[Mots-clefs] Joint de dilatation
[Mots-clefs] Rail
[Mots-clefs] Rail à gorge
[Mots-clefs] Soudure
[Mots-clefs] Soudure aluminothermique
[Mots-clefs] Soudure électrique
[Mots-clefs] Suisse
[Mots-clefs] Tramway
[Mots-clefs] Voie
[Année] 1951Index. décimale : 3124 Tramway et métro léger urbain - infrastructure, ouvrage d'art, superstructure, énergie - entretien, réparation, renouvellement de la voie, modification du plan de voie Résumé : Dans la construction moderne des voies ferrées, la tendance est à l'élimination des joints assemblés par des éclisses. Si, pour les voies de chemin de fer posées en plateforme indépendante, les rails ne sont soudés que par longueurs de 36 m pour des questions de dilatations, pour les rails à gorge, enterrés dans le sol, la soudure d'un réseau complet est possible, ce type de rails étant à l'abri de la dilatation. Les tramways de Copenhague utilisent trois systèmes de soudure, avec des domaines d'application spécifiques. La soudure au thermite est utilisé pour la construction de nouvelles voies, la soudures oxy-acétylénique permet de recharger les joints de rail et la soudure électrique est utilisée pour les remplacements de tronçons de rail sur les voies en service. En Suisse, la tendance est à l'augmentation de l'emploi de la soudure électrique.
in Les transports publics > An. 7, no 4 (Avril 1951) . - P. 6-7[article] La soudure des joints de rails [texte imprimé] / A. Maurer, Auteur . - 1951 . - P. 6-7.
Langues : Français (fre)
in Les transports publics > An. 7, no 4 (Avril 1951) . - P. 6-7
Catégories : [Mots-clefs] Chemin de fer
[Mots-clefs] Copenhague
[Mots-clefs] Coût
[Mots-clefs] Danemark
[Mots-clefs] Dilatation
[Mots-clefs] Infrastructure
[Mots-clefs] Joint de dilatation
[Mots-clefs] Rail
[Mots-clefs] Rail à gorge
[Mots-clefs] Soudure
[Mots-clefs] Soudure aluminothermique
[Mots-clefs] Soudure électrique
[Mots-clefs] Suisse
[Mots-clefs] Tramway
[Mots-clefs] Voie
[Année] 1951Index. décimale : 3124 Tramway et métro léger urbain - infrastructure, ouvrage d'art, superstructure, énergie - entretien, réparation, renouvellement de la voie, modification du plan de voie Résumé : Dans la construction moderne des voies ferrées, la tendance est à l'élimination des joints assemblés par des éclisses. Si, pour les voies de chemin de fer posées en plateforme indépendante, les rails ne sont soudés que par longueurs de 36 m pour des questions de dilatations, pour les rails à gorge, enterrés dans le sol, la soudure d'un réseau complet est possible, ce type de rails étant à l'abri de la dilatation. Les tramways de Copenhague utilisent trois systèmes de soudure, avec des domaines d'application spécifiques. La soudure au thermite est utilisé pour la construction de nouvelles voies, la soudures oxy-acétylénique permet de recharger les joints de rail et la soudure électrique est utilisée pour les remplacements de tronçons de rail sur les voies en service. En Suisse, la tendance est à l'augmentation de l'emploi de la soudure électrique.
Titre : Nicolas Riggenbach Type de document : texte imprimé Auteurs : J. Goumaz, Auteur Année de publication : 1951 Article en page(s) : P. 10-11 Langues : Français (fre) Catégories : [Mots-clefs] Crémaillère
[Mots-clefs] Riggenbach, Niklaus
[Mots-clefs] Suisse
[Mots-clefs] [Biographie]Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : Nicolas Riggenbach est né à Guebwiler le 21 mai 1817. Orphelin de père à l'âge de 10 ans, il est placé dans la famille d'un industriel de Bâle, mais vu ses piètres résultats scolaires, il est renvoyé chez sa mère à l'âge de 15 ans. Il entre dans une fabrique de rubans comme apprenti copiste, mais ce métier ne l'intéresse pas, il veut devenir mécanicien. Contre l'avis de sa mère, il apprend ce métier et entreprend son tour de France à l'âge de 19 ans pour se perfectionner. A 20 ans, il est contremaître dans la plus grande fabrique de soierie de Lyon. Il part pour Paris et, se rendant compte que les bases techniques lui font défaut, il prend des cours du soir sous la direction d'un futur ingénieur. En 1839, il assiste au départ du premier train de Paris à St-Germain et décide de consacrer sa vie à la construction de locomotives. Il est embauché par la fabrique de machines Kessler à Carlsruhe où il travaille à la construction de la première locomotive allemande. Il participe ensuite à la construction des quatre locomotives destinées à la ligne Zurich-Baden, il les convoie à Bâle et conduit le premier train de Suisse. En 1855, il est nommé chef des ateliers du Central suisse. Suite à de mauvaises expériences de manque d'adhérence sur la ligne du Hauenstein, il imagine qu'avec une crémaillère la situation pourrait être améliorée et se rend compte qu'elle pourrait être utilisée sur des rampes beaucoup plus fortes. Il entreprend de réunir les fonds pour construire une ligne de Vitznau au Righi, qui est inaugurée en mars 1871. La réussite est complète et les commandes affluent de partout. Il quitte les ateliers d'Olten et fonde la Société internationale des chemins de fer de montagne dont les ateliers sont à Aarau. Malheureusement, les affaires ralentissent et la société disparaît. Nicolas Riggenbach part en Inde pour dresser les plans d'un important chemin de fer à crémaillère. A son retour à Aarau, il repart à zéro. Il a alors 63 ans. Les commandes affluent de nouveau et il ne peut aller partout où on le demande. Il décède en 1899.
in Les transports publics > An. 7, no 4 (Avril 1951) . - P. 10-11[article] Nicolas Riggenbach [texte imprimé] / J. Goumaz, Auteur . - 1951 . - P. 10-11.
Langues : Français (fre)
in Les transports publics > An. 7, no 4 (Avril 1951) . - P. 10-11
Catégories : [Mots-clefs] Crémaillère
[Mots-clefs] Riggenbach, Niklaus
[Mots-clefs] Suisse
[Mots-clefs] [Biographie]Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : Nicolas Riggenbach est né à Guebwiler le 21 mai 1817. Orphelin de père à l'âge de 10 ans, il est placé dans la famille d'un industriel de Bâle, mais vu ses piètres résultats scolaires, il est renvoyé chez sa mère à l'âge de 15 ans. Il entre dans une fabrique de rubans comme apprenti copiste, mais ce métier ne l'intéresse pas, il veut devenir mécanicien. Contre l'avis de sa mère, il apprend ce métier et entreprend son tour de France à l'âge de 19 ans pour se perfectionner. A 20 ans, il est contremaître dans la plus grande fabrique de soierie de Lyon. Il part pour Paris et, se rendant compte que les bases techniques lui font défaut, il prend des cours du soir sous la direction d'un futur ingénieur. En 1839, il assiste au départ du premier train de Paris à St-Germain et décide de consacrer sa vie à la construction de locomotives. Il est embauché par la fabrique de machines Kessler à Carlsruhe où il travaille à la construction de la première locomotive allemande. Il participe ensuite à la construction des quatre locomotives destinées à la ligne Zurich-Baden, il les convoie à Bâle et conduit le premier train de Suisse. En 1855, il est nommé chef des ateliers du Central suisse. Suite à de mauvaises expériences de manque d'adhérence sur la ligne du Hauenstein, il imagine qu'avec une crémaillère la situation pourrait être améliorée et se rend compte qu'elle pourrait être utilisée sur des rampes beaucoup plus fortes. Il entreprend de réunir les fonds pour construire une ligne de Vitznau au Righi, qui est inaugurée en mars 1871. La réussite est complète et les commandes affluent de partout. Il quitte les ateliers d'Olten et fonde la Société internationale des chemins de fer de montagne dont les ateliers sont à Aarau. Malheureusement, les affaires ralentissent et la société disparaît. Nicolas Riggenbach part en Inde pour dresser les plans d'un important chemin de fer à crémaillère. A son retour à Aarau, il repart à zéro. Il a alors 63 ans. Les commandes affluent de nouveau et il ne peut aller partout où on le demande. Il décède en 1899.